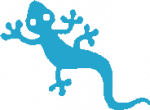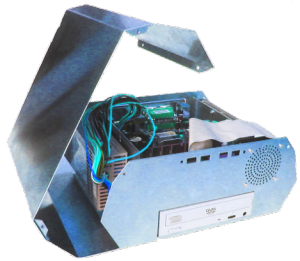Le rêve des mondes
Onitopia est une nouvelle qui a été écrite par Mathieu Rigard en mettant en forme une série de rêves persistants effectués trois semaines durant.
téléchargez onitopia_m.rigard.pdf pour une lecture hors ligne
Il suivait ce manège du regard depuis maintenant un bon moment. La preuve : ses yeux roulaient au rythme de la rotation des voitures de bois en suivant une orbite ovoïde. Sam s’en fichait, il avait son bel habit bleu et, en poche, de quoi prendre une pomme d’amour à la vendeuse tout en haut dans son camion entre la guimauve et les gaufres.
Et la chenille tournait et les rires fusaient et il regardait.
Plus loin, de sa démarche lancinante et déambulatoire s’approchait la partie la plus méridionale et cinéphile de sa famille : C’était Mon Oncle incarné ! D’autres parties, hétéroclites mais de souche commune et qui avaient renoncé à lui emboîter le pas, suivaient en riant de conserve.
_ Alors, on y va ?
Lança l’Oncle arrivé à sa hauteur.
Sam souri d’un sourire sans bave et comme il n’y avait plus grand monde dans le manège, ils se mirent à discuter avec le manégrier.
Alors ?
Ben oui.
Du coup, comme ils étaient à peu près d’accord sur tout, il leur proposa de monter : « de toute façon il faut bien le faire travailler sinon il rouille », leur dit-il avec ce bon sens caractéristique du petit artisanat itinérant.
En bonne intelligence ils grimpèrent dans la voiture qui suivait la voiture de tête et rirent en anticipant les joies à venir. Ce qu’ils ne savaient pas c’est que la chenille de ce manégrier là était particulière. Elle avait de véritables roues et, par conséquent, il fallait la conduire.
Sam, particulièrement intelligent ce soir-là, trouva ça étrange. Comme une chenille de manège par définition ça se mord la queu… l’intérêt de la conduire et tout… Ce qu’il ignorait, le pauvre, c’est que dans son infinie sagesse, le créateur du manège avait pourvu sa réalisation d’un circuit comme celui des kartings mais avec de jolis arbres. Lorsque la chenille disparaissait derrière la partie qu’on voit (c’est à dire lorsqu’elle apparaissait dans la partie qu’on voit pas, derrière) et bien elle se promenait dans le circuit.
Trop bien !
Un tour entier, pour Sam et compagnie, rien que pour le plaisir. Youhou ! Trop la classe !
Et comme, décidément, le manégrier aimait vraiment bien la discussion plaisante et sobre de Sam et de sa famille, il leur proposa non seulement un second tour à l’oeil, mais en plus, que Sam conduise la seconde chenille qu’il allait affréter pour l’occasion. C’était une encore plus belle chenille. Elle était brillante comme une coulure de vernis sur un pot usagé et Sam l’avait pour lui tout seul.
Ils attendirent que tout le monde prenne place dans une ambiance musicale disco, mais cela ne dura pas trop longtemps puisque tout le monde était déjà installé et que Sam était prêt lui aussi.
Le patron du manège sus-cité indiqua à Sam le moment du départ avec un clin d’oeil complice et les voilà tous partis, cahotin cahotant, vers de nouvelles aventures.
Les cris de joie avec un peu de trouille repartirent en cœur lorsque l’avant des deux chenilles, côtes à côtes, s’engouffra derrière la peinture de colline en trompe l’oeil pas averti (qui de ce fait n’en vaut pas deux et donc n’accède pas à la 3D… c’est, il faut le dire, un tout de même vieux manège).
Là, Sam manqua quelque peu d’expérience. Émerveillé par le paysage bucolique et néanmoins rappelant un circuit de karting, il se laissa distancer par la chenille du sieur propriétaire. Crénons quelle beauté ! De-ci de-là, des poustoufants anglophiles broutent nonchalamment l’herbe grass, tandis que les petits papillons chantent. La nature, quoi, avec quelque chose d’organisé comme un jardin à la française. D’ailleurs, ne serais-ce pas un château de Versailles que j’aperçois là-bas dans le fond, se susurra Sam in petto ?
Le voilà qui s’élance déjà en plein dans le paysage et fait serpenter sa chenille dans les traces de celle de devant. Les cheveux au vent et les yeux qui piquent de bonheur, les voilà tous riants et roulant vers le Versaillais château.
Arrivés au seuil, après une délicieuse descente au paradis verdoyant de l’endroit (note de l’édition : de ce côté c’est l’endroit, du côté de la fête foraine c’est bien entendu l’envers…), Sam rejoint les autres qui l’attendent au seuil de l’entrée monumentale, frais et dispos comme une touffe d’herbe dans la rosée du matin.
Quelle splendeur cette galerie des glaces, surtout pour les gourmands et que d’objets d’art rassemblés dans ces salles aux vitrines ostentatrices ! C’est tout le Louvre qui s’est invité au château de Versailles, ma parole, s’entretient Sam, gaiement.
Les chenilles ont ralenties leur allure pour adopter une cadence plus en harmonie avec la solennité du lieu. Des miles ans d’histoire les observent de leurs petits yeux sans vie restaurés avec un méticulisme soigneux et subventionné.
Sam est en confiance. Les commandes de l’engin lui sont maintenant familières et il a envie de le montrer. Sans accélérer son allure, il oblique spontanément vers la droite et, passant une large porte en angle droit, s’enfile dans un couloir parallèle à la grande galerie. Le chemin est dégagé, il accélère d’un geste sûr, jette un regard sur sa gauche à la porte suivante, il est en train de doubler l’autre chenille ! Cool ! La prochaine porte fait face à une grosse vitrine abritant une sculpture dont la rugueuse épaisseur des traits trahit l’âge obscur de sa production sacrée et ancestrueuse.
D’un mouvement de poignet il fait prendre la direction de la porte à son engin. Nickel ! ça passe juste bien, tout comme il a prévu. Il rejoint les autres juste devant leur nez et ajuste à son visage un petit sourire content de lui mais pas trop quand même (pour ne pas faire de jaloux) et CRRRAC BiM claOUang BriZZZe : la vitrine derrière lui vole en éclat, malencontreusement heurtée par la queue de la chenille oubliée par notre ami inexpérimenté.
Tous les regards convergent vers eux et lui devint rouge. Inutile de décrire la consternation poignante qui se saisit de sa gorge déployée, à ce moment-là, par l’émotion. Sam saute à bas de son engin tandis que, sous l’effet du choc, tout le monde reste immobile. Il court à l’emplacement de la vitrine qui chut et se rassure un tout petit peu en voyant émerger des décombres la statue de pierre qui n’a pas l’air plus mal fichue qu’avant.
Ouf.
Seulement les gardiens du musée, ainsi que les visiteurs, ne semblent pas de son avis. Se propulsant alors au guidon de sa bête il embraye sauvagement, suivit de près par le-dit propriétaire non moins angoissé ainsi que sa bande de famille qui ne rigole plus du tout.
La compagnie rebrousse chemin en à peu près autant de temps qu’il me faut pour le dire. Voilà c’est fait. Puis, enfin, émerge du côté visible du manège, s’arrête, et descend, au revoir et merci.
Second ouf, éveillé celui-là, ce n’était qu’un rêve.
Un rêve. Une réalité onirique. Un monde vécu dans le sommeil. Un immonde produit de Morphée quand elle est pas gentille. Limite un cauchemar, du coup.
Il me semble que je suis au tiers dans mon sommeil. Les dégâts seront sans doute réglés par mon assurance avant le prochain rêve. Enfin… pour des objets d’arts ?
Voilà qu’il n’en est plus du tout certain.
C’est ce que j’espère en tout cas, se dit Sam tracassé au point de ne pas se rendormir tout de suite. Le plus sage, décide-t-il enfin, c’est de rêver à un bon contrat tout risque. Et il se rendort rasséréné.
Cependant rien n’est jamais aussi simple qu’on voudrait croire que ça n’est pas trop compliqué, surtout quand c’est pas réel. Cette histoire de rêve catastrophique hante encore Sam tout au long de la journée. Il la retrouve à la fin de la grande nuit dans un cauchemar d’agent d’assurance en maillot de bain trop petit qui rigole lorsqu’il lui raconte son problème. Puis c’est un rêve angoissé de prestidigitateur qui n’arrive pas à retrouver son lapin dans les coulisses du cabaret où il se produit lors de la petite nuit de 10h. Il se réveille aussi à 16h, une demi heure avant le levé du soleil de mi-après-midi, en sueur sur le lit de son bureau alors qu’il venait d’emboutir la voiture onirique dont son patron rêve depuis des mois.
Diable, ma vie rêvée devient impossible ! Se dit Sam. D’autant qu’il ne s’appelle pas Sam mais Albert, ce qui ajoute à son émois. Au moins, se dit-il, peut-être que cela pourrais plaider en ma faveur devant un tribunal.
Une idée en amenant une autre et de fil en aiguille, il pense à son ami Lucarne, le juriste prudent. Ni une ni deux, la situation étant bien trop grave pour s’appesantir en savants calculs, il décroche le téléphone et compose le numéro de son cabinet.
Trois longues sonneries retentissent dans le silence grésillant de son écouteur avant que le combiné ne soit décroché à l’autre bout de la ligne.
Une voix pâteuse grogne quelque chose dans un langage péjoratif mais pas totalement compréhensible.
Allo Lucarne, c’est Albert.
Bon sang mon vieux, mais quelle heure est-il ?
Je sais, je suis désolé, il est à peine 16h
16h ! fait l’autre, bougon, j’ai déjà eu un mal fou à m’endormir tout à l’heure à cause de ma dent contre cette secrétaire… et toi tu me lève de la média-nuit, trois quart d’heure avant l’aube et en plein rêve érotique !
Excuse moi mon vieux, répondit Albert le rouge au front, mais il m’arrive une tuile.
Depuis le bout du fil il entendit le frottement caractéristique d’une branche de lunette qui glisse entre une oreille et un combiné.
Bon, vas-y, reparti l’autre assit par la force des choses, je t’écoute.
Albert présenta brièvement Sam à Lanterne et lui parla de l’accumulation des maladresses accidentelles de ce dernier dans les rêves de ce premier.
Lanterne réfléchit un moment puis répondit avec lenteur :
Mon bon Albert : tu es dans la merde !
Diantre, répondit ce dernier, c’est bien ce qu’il me semblait. Et tu ne vois rien qui pourrait m’aider ?
Un long soupir bava mollement depuis le combiné dans l’oreille d’Albert.
Il y aurait peut être une solution, finit-il par conclure.
Albert trépigna d’impatience ce qui, au téléphone, ne rendit presque rien.
Il existe bien une jurisprudence (Dieu soit loué, se dit Al, mon ami n’a pas perdu la main), mais à la condition que Sam se constitue prisonnier.
Albert frissonna, puis reprit : « Mais c’est que je le connais à peine. »
C’est la seule façon de te disculper. Tu ne t’en sortira que si tu prouve ta bonne foi au juges, et que ce n’est pas ton inconscient qui manœuvre ce Sam.
Comment vais-je le trouver ?
Je ne sais pas. Retourne sur les terrains de rêve sur lesquels tu l’a déjà rencontré, parle-en autour de toi, essaye de savoir si quelqu’un le connaît, où il habite. Moi de mon côté je vais voir dans les fichiers de la police s’ils n’ont pas par hasard connaissance d’un maladroit sadique en liberté en ce moment. Rappelle moi dès que tu as du nouveau.
Albert n’eut pas le temps de remercier son ami, ce dernier avait déjà raccroché. Il reposa le combiné et regarda autour de lui. Par où commencer ? Il restait encore 4 bonnes heures avant la grande nuit et il en avait encore 3 a passer au travail. Prenons les choses dans l’ordre, se dit-il, tout d’abord aller m’excuser auprès de Monsieur Poljacques mon patron. La mort dans l’âme, Albert prévint sa propre secrétaire de son absence et celle du patron de sa présence. Leurs bureaux étant contigus comme leurs propres corps, elles se réveillèrent en même temps.
Albert s’assit dans l’antichambre (seul endroit d’Onitopia où il était interdit de dormir) et attendit. Il était loin de s’attendre à ce qui allait lui arriver.
Lorsqu’il fut introduit dans le vaste bureau/chambre convertible, Monsieur Poljacques lui présenta un profil de dos. Les mains croisée dans le bas de celui-ci, il contemplait le majestueux levé du troisième soleil d’Onitopia à travers l’immense baie vitrée de son 76ème étage avec ascenseur. Monsieur Poljacques était matinal, surtout pendant les heures de travail mais pas que. Son bureau jouxtait l’ancien observatoire à lunette qui avait été posé au sommet de la tour d’astronomie principale qu’il dirigeait. Le business de la prévision astronomique, heures précises des demis jours, en suivant les complexes saisons et éclipses partielles ou totalement cumulées, était particulièrement florissant depuis deux cents ans de révolution industrieuse. Savoir quand on allait se lever pour travailler et combien d’heure cela durait par jour allait de pair avec le salariat et le monde du commerce. Monsieur Poljacques était par conséquent à peu près aussi matinal qu’il était riche et puissant.
Entrez mon cher Albert, entrez.
Al n’en revint pas qu’on puisse lui dire entrez deux fois, cela cachait quelque chose.
Merci Monsieur le directeur
Monsieur Poljacques, sans se retourner, enchaîna : « Vous devez vous demander pourquoi je vous ai fait venir, n’est-ce pas ? »
Là, Albert laissa négligemment tomber sa mâchoire inférieure sur son veston tout neuf, y laissant une imperceptible trace humide.
Poljacques repris après une pause légèrement théâtrale en se retournant pour faire face à son interlocuteur.
Oui, mon cher, c’est vous, fidèle bras gauche, celui du cœur, que j’ai choisis pour prendre la tête de la branche la plus prometteuse de notre entreprise : vous allez mener un combat de premier plan autour du développement de notre Section Paradoxale.
Albert ouvrit des yeux grands comme les deux soleils de 10h et repris le contrôle du bas de sa bouche avant de s’entendre répondre : « L’activité de ponctuation des rêves ? Mais je croyais nos recherches sur influence des rythmes astro au seul stade de recherche fondamentale ? Serions-nous arrivé à influencer la durée ou la qualité de notre sommeil paradoxal ? Il était peut-être surprit, mais c’était un pro.
Et bien mon cher, ce sera à vous de me le dire, moi-même je n’y comprends rien, mais vous ne serez pas seul, mon fils Samuel vous secondera. Devant la mine de son second, Poljacques se sentit obligé d’ajouter : « mais ce sera sous votre direction unique, Samuel Poljacques n’est encore que novice, vous verrez, il est un peu dans le soleil de midi mais il ne demande qu’à apprendre. Vous serez le tuteur rêvé pour lui, j’en suis convaincu. »
Sur ce il se tourna vers son bureau et commença à y déplacer des piles de papier pour signifier la fin de l’entretien.
Lorsqu’Albert, encore tout retourné, fut sur le seuil il lui lança enfin : « A oui, et au sujet de ma voiture… n’en parlons plus, je viens de l’acheter, j’en rêverais une autre ».
Une fois la porte du bureau fermée Albert aperçus l’air goguenard des deux secrétaires siamoises. Vendeuses de mèche, pensa-t-il. Puis il ajouta à haute voix : « a oui, au fait Nadège, nous déménageons notre bureau au sous sol avant ce soir », avant de rentrer dans celui qui jusque là était le sien en ricanant.
L’après midi fut sinistre. Albert, fatigué par ses sommeils cauchemardesques n’osait pas dormir de peur de voir l’autre pointer le bout de son nez. En pareille circonstance il était pourtant de bon ton d’afficher à sa porte le célèbre panneau : « ne pas déranger, je rêvasse tout un tas de solutions simple a un problème épineux ». Albert en pris son parti, il devrait faire tout, du moins le maximum, en restant éveillé. Fébrile, il fouilla dans le tiroir de son bureau jusqu’à en extraire un organigramme de l’entreprise. Diantre ! La photo aux couleurs bavantes sur la planche aux fausses allures d’arbre généalogique correspondait : le Samuel du directeur-président général était bien SON Samuel persécuteur : Le sam ! La partie s’annonçait serrée pour Albert qui du ouvrir la porte aux déménageurs qui emportèrent son secrétaire avec les tiroirs encore pleins.
Quelques minutes après, ce furent les ambulanciers qui le trouvèrent tout rêveur pour lui annoncer qu’ils emportaient sa secrétaire, avec ses artères toutes vides. Sa tentative de se désolidariser de sa sœur via les ciseaux du bureau avait été un échec. Ou disons, une demi-réussite.
Maintenant Albert avançait en terrain connu. Il n’était plus seul et une poignée d’ombres avançaient tout comme lui dans la muraille de la citadelle. Il sera son fusil automatique contre son flanc : ça recommençait.
Oui, le lieu, les sensations, avaient cette petite musique entêtante de déjà vu. Comme ces petits airs, répétés en boucle dans les films de Cow-boys quand ça-va-barder-vous-allez-voir-c’que-vous-allez-voir.
Dans l’extrémité gauche de son champs de vision il perçus confusément que les autres se rassemblaient pour étudier la situation. Albert connaissait déjà le senario. Il n’attendit personne pour contourner la muraille par la droite.
La colline montait en pente douce le long du mur d’enceinte. Aucune activité n’était perceptible à l’intérieur ni alentour. Albert était maintenant seul et avançait d’un air décidé. Aucun oiseau ne chantait ce qui l’amena à déduire que le silence était total.
Plus il se montait la pente escarpée, plus il savait approcher du dénouement du rêve. Conscient d’avoir déjà vécu ce moment, il baissa instinctivement la tête alors qu’il arrivait à la hauteur du haut du rempart. « je ne me ferait pas avoir cette fois, pensa-t-il en serrant les dents ».
Il l’aperçu au moment même où il risquait un coup d’oeil par dessus le mur. Il arma et tira a l’aveugle, sans viser, la crosse de son fusil contre le flanc. La rafale déchira le ciel et la quiétude inquiétante du lieu aussi sûrement qu’un grand écart dans un pantalon trop petit. Les traits partirent en sifflant arroser le rebord du mur dans une gerbe d’éclats rocheux et de poussière. Au loin, sur le chemin de ronde, la silhouette ne daigna même pas se mettre à l’abri. En soi, son comportement avait déjà quelque chose d’insultant. Albert serra les poings, cette fois, et une seconde rafale partie se perdre dans les airs bien au-dessus de sa cible. Une vague sueur de trouille commença à lui perler aux commissures des lèvres. Il ne l’aurait pas non plus cette fois. C’était bien lui, maintenant le doute n’était plus permis. Ce rêve de débarquement avec avance sur la capitale d’Onitopia a libérer devait dater de 3 ou 4 jours dans la mémoire d’Albert. Il ne se terminait pas bien, mais comme souvent, il n’y avait pas prêté attention… un rêve a reterminer parmi d’autres. Mais maintenant il avait identifié l’intrus en son sein. Le vers dans la pomme. Samuel le fourbe, Samuel la gangrène, le vénérien était encore là a lui pourrir la nuit.
Albert décrocha son chargeur d’un geste leste du poignet et en enclencha un nouveau du même mouvement. Trop tard, l’autre l’avait repéré et déjà les pruneaux se mirent à pleuvoir dru autour de lui. La plaine pentue dans son dos, la muraille devant lui : foutre Dieu ! Peu d’autres opportunités, comme la dernière fois. Ce qu’il voyait là-haut plus loin sur les remparts n’était qu’une silhouette, mais au fond de lui-même Albert sentait le sourire moqueur et le sarcasme facile.
Tenter un coup de Trafalgar et sauter à l’intérieur de l’enceinte par là où le rempart n’était plus qu’un muret de pierres aurait été une option sans l’armée toute entière de salops qui s’y trouvait sans doute. Une balle siffla à l’oreille d’Albert. Trop proche. C’est marrant comme c’est toujours trop proche, une balle, quand ton oreille l’entends siffler. Albert ne fit ni une ni deux, il se précipita dans la pente à toutes jambes pour venir écraser son dos contre le rempart là où il était déjà assez haut.
Comme il l’avait prévu, les tirs cessèrent, faute de visibilité sur la cible.
Au fond de son lit, Albert souffla et remua nerveusement. Dans son rêve il savait avoir déjà vécu la scène… et perdu la partie en même temps que son précieux sommeil. Il n’avait pas beaucoup d’alternatives. Il décida de retenter le coup.
Glissant une main à sa ceinture il dégoupilla une grenade. Le temps de latence avant l’explosion était crucial et, bien entendu il ne savait foutre pas de combien il pouvait être, ce foutu temps de latence. Pas moyen de se rappeler non plus combien il avait compté la dernière fois. Tant pis. Il compta jusqu’à trois et lança la grenade de toute ses forces vers le haut du rempart au dessus de sa tête. L’autre était là, pour sûr, à se pencher comme un saule afin de l’apercevoir pour lui régler son compte.
La grenade monta à la verticale jusqu’au sommet du rempart. Samuel la regarda incrédule se stabiliser juste devant son nez. Tout à coup, elle inversa son mouvement, répondant ainsi à la dure loi de la gravité qui ne manquait pas d’accabler Onitopia à l’instar d’autres mondes réels ou rêvés.
En bas, Albert en éprouva une sorte de soulagement masochiste : « j’en étais sur, trois c’était carrément pas assez ! ». La grenade rebondit à ses pieds et il eut un sursaut de rébellion face au destin moqueur. Prenant son élan, une main fermement appuyée contre le mur il envoya un grand coup de pieds dans la grenade et la fit voler à vingt pas. Elle explosa dans un bruit mat.
Hé hé, quelque chose changeait. Il n’était pas encore éveillé, il n’était pas encore mourut.
Albert, le sourire en coin, jouit de cette petite victoire sur la fatalité le temps de compter jusqu’à sept. Une deuxième grenade, ressemblant étrangement à la sienne rebondit durement sur le sol auprès de lui.
Crac ! Albert se réveilla intérieurement trempé de sueur. Je dis intérieurement parce que ses draps et son Marcel de nuit étaient secs mais que, honnêtement, s’il avait sué à cause de son rêve il aurait été véritablement trempé de sueur. En même temps comme sa fait un peu cliché, ma femme, qui est ma première lectrice (dans tous les sens de ce terme sibyllin) m’a dis : « c’est bien mais ça fait un peu cliché le coup du mec qui se réveille « trempé de sueur ». Je les ai sentis dans le son de sa voix les guillemets sur « trempé de sueur ». Déjà ça c’est pas bon, les guillemets. Alors quand en plus elle commence sa phrase par : « c’est bien », là il faut que je change un truc. C’est là que j’ai pensé à « intérieurement trempé de sueur ». Ça se fait plus beaucoup les trucs intérieurs, je sais, sans doute à cause des adaptations cinématographiques, c’est pas très photogénique, mais comme moi je fais ça pour mes lecteurs…
Bref, en un mot comme en mille, il se réveilla avec cette impression étrange dans la bouche. Une amertume qu’il connaissait maintenant trop bien et que lui laissait toujours le passage onirique de celui qui était devenu, sommeil après sommeil, sa bête noire : Samuel Pauljacques.
_ L’enfoiré, mais pourquoi fait-il ça ? Pourquoi me fait-il ça à moi ?
La pièce encore endormie ne prit même pas la peine de lui renvoyer l’écho étouffé de sa plainte muette. D’ailleurs, ce nouveau bureau le connaissait à peine. Albert se sentit seul, et moi j’espère que ma femme ne va pas rentrer trop tard pour que je puisse manger avec.
En attendant des jours meilleurs, nous nous dîmes tous deux que la meilleure chose que nous avions à faire c’était de nous remettre au travail, et c’est ce que nous fîmes.
Le traquenard
Onitopia. Planète au petits jours, berceau de la vie, fin sanctuaire aux six petits matins par vingt-six heures, paradis des dormeurs et des rêveurs.
Onitopia occupait dans l’Univers un emplacement de choix. Si la Création issue du Big Bang était un stade de Foot, alors Onitopia était une loge VIP avec vue imprenable sur le terrain, écrans couleurs pour les ralentis, champagne et hôtesses en petites robes moulantes.
Ses trois soleils assuraient un roulement incessant alternant lumière et obscurité. Le plus petit des trois, Hermestri, allant même jusqu’à effectuer trois rotations autour de la planète, tandis qu’elle tournait sur elle même en une journée de 26 heures avec en été, Hermès-le-grand a sa droite et Luxia le moyen à sa gauche (l’inverse étant bien entendu l’apanage de l’hivers Onitopien). La nuit noire représentait donc, vous l’aurez compris, un bien précieux qui se présentait plus souvent qu’on ne pouvait le croire malgré tout (5 à 6 fois par 26 heures, suivant) mais ne durait que de quelques dizaines de minutes à une poignée d’heures. Les habitants de cette astre singulier avait, et c’est bien naturel, développé une aptitude à s’endormir profondément en un instant, tout comme à être opérationnels très vite au saut du lit. Certains animaux, haut degrès de symbiose, arrivaient même lorsqu’ils étaient nocturnes, à rêver en chassant tandis que d’autres, diurnes, rêvaient qu’ils se faisaient manger. Bref, cette histoire ne se déroule pas du tout sur Terre.
L’exposition des continents à la lumière, énergie vitale généreusement distillée par les trois astres flamboyants, était rythmée par l’action bienfaitrice de deux lunes placides : l’une orbitant autour de la planète elle-même, l’autre autour d’Hermetri.
Onitopia. Un monde de poètes et d’écrivains, de rêveurs et d’amoureux. Un paradis, n’eut été l’activité industrieuse et lucrative des humains qui la peuplaient, avec son corollaire fatal d’envie, de jalousie, bref : la compétition.
C’était tout à fait ce genre de pensée que ne ruminait pas Albert alors que, instantanément sur pieds, il emménageait et aménageait son nouveau bureau. Non, Albert était soucieux. Tout en rangeant ses dossiers, en épinglant son poster de : « couché de soleil impression soleil levant sur la côte du jour sans fin au mois d’entourloupette », en mettant sous clés son agrafeuse parce que les agrafeuses on se les fait toujours piquer, Albert pensait à celui qui depuis des semaines venait hanter ses meilleurs rêves, son pire cauchemar, son désormais plus proche collaborateur : Jules Pauljacques.
Avec un regard circulaire satisfait sur la pièce, il arrangea enfin les petits coussins de son lit de bureau.
« Comme on fait son lit on s’couche » pensa Albert avec un hochement de tête approbateur. Selon sa montre à synchronisation perpétuelle avec les serveurs de temps relatif du Centre d’Astronomie Principal, montre qu’il avait contribué à créer, l’obscurité de la petite nuit de 16h ne viendrait pas avant un bon quart d’heures… Mais il avait si mal dormis ces derniers jours. Il s’étira en baillant. La minute suivante il dormais. Un filet brillant au coin de la bouche et, progressivement, une bosse levant les plis du drap sous lesquels il s’était glissé, juste là, entre la tête et les pieds.
La nuit tombait enfin lorsqu’il se souvint de la promesse qu’il avait faite à un amis viticulteur. Ce dernier participait ce jour à une fête, dans leur village natal et il devait y présenter son vin nouveau. Il avait promis. Effort. Un ami d’enfance : une promesse qui compte double. Et puis mince ! Il avait autant besoin de se changer les idées que de dormir.
Albert se redressa d’un bond, enfila sa veste d’un geste ample et pressa le bouton de l’interphone interne un peu trop rapidement avant de se souvenir qu’il ferait bien mieux d’envoyer des fleurs à la famille de sa défunte secrétaire. Avait-elle un mari, était-il polygame ? Autant de questions qu’il ne pourrait plus lui poser maintenant. En tous cas, cela ne l’empêcherait pas de prendre son quart de journée du soir.
Dans la capsule magnétique à haute vélocité qui l’emportait vers le village de son enfance, Albert admirait les derniers rayons de Luxia se couchant. Après tout, à quoi bon se frapper ? Le monde n’était-il pas toujours aussi magnifique autour de lui ? Est-ce que ça lui ressemblait, ça, de s’apitoyer sur son sort ? Il devenait nombriliste, tristos, ne profitait plus de la vie et tournait limite parano. Il respira un grand bol d’air en descendant de son transport qui repartit, vide, vers la grande ville. Ça sentait l’herbe fraîchement coupée, le dessous d’bois et la clairière enchantée. Albert rit de lui-même, comme un enfant heureux et partit rejoindre son ami parmi les stands de victuailles et le peuple en liesse.
Celui-ci n’était pas là. Au comptoir où trônait sa production il fut tout de même reconnu. « Offert par la maison », s’entendit-il dire avec jubilation. Le breuvage était pertinent et efficace.
Albert en était là de sa dégustation lorsqu’une voix connue le tira de sa contemplation épicurienne. « L’Albert ! » Il se raidit. « ça, crénon, c’est l’Albert ! ». Il se retourna prudemment et sourit : « Le Julot ! ». Merde, Julot, pensa-t-il. Le tâcheron du village. La gentillesse incarnée… comme un ongle. La simplicité faite homme : le boulet par excellence ! Vaut-il mieux être mal accompagné que seul, commença-il a réfléchir ? L’autre ne lui laissa pas le temps de tergiverser avec lui-même.
_ Moi qui commençait à croire que je trouverais personne de connu pour trinquer dans ce paysage de costumes de la ville. Lança-il.
Les tournées s’enchainairent. Un vrai traquenard. Et le copain qui n’arrivait pas.
Après à peine 5 ou 6 canons, Albert signa l’armistice. Prétextant le lever du soleil proche, le travail en retard, une migraine de carabinier et la nécessité impérieuse d’uriner, il se dirigea vers la caisse du comptoir d’un pas chancelant mais résolu.
A ce moment précis un cris, venant du plus profond des terreurs que seule l’enfance devrait connaître, monta en lui, se coinça, pour finalement se perdre dans sa gorge en un gargouillis désolant.
Lui !
Car effectivement, lui, c’était !
Il était là, derrière le comptoir, arborant la mine affairée de celui qui fait mine d’être trop occupé pour le reconnaître.
Il était là depuis le début. Le fourbe ! L’infâme ! Albert grimaça de rage. Dans mon rêve de copain d’enfance, pensait-il !
Albert enfonça la main au plus profond de sa poche avec la ferme intention d’en finir au plus vite avec tout ça. « Je règle mes consommations et bye bye. Plus de consommations à payer et plus de guichetier, plus de guichetier et plus d’énergumène suceur de rêve », se disait-il dans une demi conscience.
Au contact des clés et du tissu, le bout de ses doigts se raidit et déglutit difficilement. Sa main monta alors en tremblant vers sa poche de veste. Son portefeuille n’y était pas, le cauchemar était total.
Malgré son envie de ne pas le faire, il releva la tête et le gros visage de Sam vint occuper toute la place dans son imagination, un sourire énigmatique teinté de sadisme au coin des lèvres. Celles-ci s’écartèrent enfin sur une béatitude plus large, laissant paraître une dentition en or qui éblouie Albert, lui brûlant la rétine ainsi qu’une partie des sourcils.
Janussaire, le soleil du jour-du-soir, se levait et tintait avec fracas contre les atours prothésistes et extravagants du malotrus. Bien qu’endormis et sachant cela consciemment impossible, Albert allait griller sur place s’il restait exposé, ne serais-ce qu’une minute de plus, à la profonde réflexion de ce sourire narquois.
Étais-ce la forme ronde de Janussaire ou bien celle de sa bonne étoile, toujours est-il que sa main gauche, qui n’avait jamais renoncé, exhuma de fond de l’autre poche une pièce. Cette pièce, elle l’identifia elle-même comme un centième de Boule (monnaie Onirique). Plutôt que de se mettre à pleurer (hydratation lacrymale tant humiliante qu’inefficace), Albert décida d’exhiber ce fruit, bien maigre, de son pantalon.
Tel un talisman protecteur, Albert leva la pièce devant son visage, l’interposant en quelque sorte entre lui et l’autre, fragile rempart à la folle tournure que prenait son rêve.
A ce moment précis le sang d’Albert ne fit qu’un tour dans son sac. Comme mécaniquement guidé par une force supérieure et bonne, le sourire narquois fièrement arboré passa dans le même mouvement d’un visage à l’autre. Le sourire étincelant de Sam s’éteint momentanément : la pièce en question était, ô force improbable de rêve, frappée du chiffre 2 000, c’était une pièce de deux mille Boules !
Hé, hé. Albert jubilait extérieurement, de façon relativement puérile certes, mais jubilatoire tout de même. Et ce, jusqu’à ce que soudain, la pièce se mit à briller de manière outrancière. Elle brilla tant et si bien qu’à son tour elle éblouie l’assemblée ébahie.
Les yeux d’Albert papillonnaient, piqués qu’ils étaient par la lumière trop forte dans son bureau pourtant obscur. Effectivement, bien des ophtalmologues vous le diront, il n’est rien de plus éblouissant que la lumière dans le noir, tout comme les diététiciens s’accordent à dire qu’il est dangereux de manger trop gras lorsqu’on meure de faim. Bref, le regard d’Albert s’arrêtât sur un éclat doré qui venait directement de la porte vitrée de son bureau. Il avait inspecté cette porte en arrivant et la plaque fraichement posée qui affichait : « Albert Doubitchou, Dir. Section paradoxale et ponctuation des rêves ». Les lettres étaient bien ciselées, tout était correct. L’éclat de lumière venait bien du côté de sa belle plaque neuve, mais à y regarder de plus près ça n’était tout de même pas véritablement d’elle qu’il venait.
Albert se redressa et s’approcha de la porte. Oui. La lumière assassine venait d’un cadre ornemental accroché sur le mur opposé du couloir, qui réfléchissait lui-même trop intensément à son goût, surtout pour une aquarelle.
Albert ouvrit la porte et sorti dans le couloir. Celui-ci faisait un coude à l’angle de son bureau. Il régnait une étrange pénombre dans se bras mort du couloir. Celui-ci n’était effectivement éclairé que par un unique spot éclairant de plein fouet une unique porte. Sur la porte une plaque dorée semblable à la sienne : la fautive, le miroir aux alouettes, l’éblouissante clarté.
Nous y sommes : surtout lui.
Albert n’eut pas besoin de s’approcher pour pour lire le nom qui y était gravé.
En fait, le pauvre n’en pouvait plus. Il n’en voulait pas particulièrement à son persécuteur, il était au delà des sentiments, anesthésié par le manque de sommeil, le manque de rêves ré-créateurs, le manque d’espoir. Si la psychologie avait existé sur Onitopia, on aurait pu dire qu’il était limite Nervous Breakdown, en pleine dépression, caput, niqué d’la tête, cactus, lysopaine, fauché au plus près des racines de son envie d’être au monde.
Comme un zombie, il se dirigea d’un pas lent et résigné vers le bureau de Samuel Pauljacques. Pathétique vision d’un homme ayant abandonné toute fierté. Sinistre image de la reddition. Le désespoir amidonné d’échec. L’agneau servile, offrant sa gorge au bourreau.
Il entra sans frapper, comme répondant à l’appel muet de son tourmenteur : « Viens à moi, ai confiance. De tes maux je peux hâter la fin… définitivement ».
Mais à ce qu’il vit, il ne pouvait être préparé.
L’homme qu’il avait en face de lui, relié à un ensemble complexe de machines et de tuyaux, montrait un visage étrangement semblable au sien. En pire.
Traits tirés, pâles. Joues creuses, yeux profondément enfoncés dans leurs orbites cerclées de noir. Une grimace se voulant un sourire entendu disant : « Hé oui, tu vois, en fait j’en suis là ». Le jeune homme du trombinoscope, le fils de son père avait été mangé par cet autre sans âge.
La stupeur saisit Albert au menton. Ainsi anesthésié ce dernier se rapprocha sensiblement de son cou. Pris à son tour, ce dernier étrangla un râle avant de transmettre la raideur du choc au poumons et au cœur qui rata un battement, pour enfin lui nouer les entrailles et l’estomaquer.
Dans cette pauvre loque humaine, Albert ne reconnaissait qu’à peine le jeune avorton qui se tapait l’incruste depuis maintenant trois mois dans ses rêves. Sa résignation se transforma en incrédulité. Il reprit peu à peu confiance en lui. Après tout il était encore un peu présentable, lui. Quelques nuits de sommeil dans un centre de relaxation horizontale, une cure de rayons noirs d’obscurité et deux ou trois biscuits REM et n’y paraitrait plus. Alors que l’autre, là…
Merde alors ! Pensa-t-il subitement. C’est pas possible d’avoir eu peur de celui-là ! J’aurais dû tout de suite lui claquer deux baffes avant de le laisser me pourrir la vie.
Tout à ces pensées regaillardisantes, Albert se redressa et adopta une stature droite et altière. Il allait déjà bien mieux.
_ Bonjour, dit-il enfin.
Une pause, Albert cherchait ses mots. Dites-donc, partit-il enfin énergiquement, il semblerais que nous allons travailler ensemble dorénavant.
L’autre hocha la tête,. Cette dernière tombait sur sa poitrine et il ne la relevait qu’à grand peine.
Albert reprit : « Bon ben alors, bonne journée ». Et il allait prendre congés, fier de son courage retrouvé face à l’hydre infâme, prêt a affronter le monde entier et la nouvelle secrétaire qu’il allait avoir, lorsque l’autre momie s’éclaircit la gorge d’un profond raclement caverneux.
_ Monsieur Albert ?
Le cœur d’Albert se mit à battre très fort. Voilà que l’autre allait lui dire un truc. Merde, pas cool. Qu’est-ce qu’il va bien encore trouver pour m’asservir et me sucer le sang ce foutu Vampire, pensa-t-il.
_ Je ne suis pas particulièrement fier de ce que je fais.
_ A non ? (Quel con !) Puisque Albert avait prononcé ces deux derniers mots dans sa tête, l’autre fit mine de n’avoir rien entendu et reprit :
_ Savez-vous que la texture même de vos rêve est un aliment extrêmement riche pour moi. Je n’avais par ailleurs encore jamais trouvé un sujet capable de survivre à plusieurs jour de mon, comment dirais-je, inclusion dans son territoire nocturne. Je suis positivement épaté. Vous êtes un sujet remarquable à plusieurs titres.
_Un collègue, rectifia Albert. Un collègue remarquable à plusieurs titres. Je dirige ce département de prospection des efficiences oniriques au même titre que vous, voire plus !
La momie racla et bruissa derechef. Albert pris ça pour un rire, en fait, du coup, il le prit plutôt mal.
_ Vous avez l’air de penser autrement ?
Samuel Pauljacques prit le temps de laisser planer un doute avant de répondre ;
_ Non, c’est vous qui avez raison, Albert, tant que vous êtes encore en vie.
C’en était trop. Le sang d’Albert ne fit qu’un tour dans ses veines. Il était bien décidé à secouer le joug qui le retenait prisonnier de cet être sans vergogne, et si cela ne se faisait pas à l’amiable, si cela ne pouvait se régler juridiquement, alors c’est bien la nuit prochaine qu’il réglerait ses comptes oniriques.
_ C’est exactement ce que j’allais dire, mon cher SAM, et il prononça ce diminutif en majuscule, pour en exagérer le côté familier avec le désir puéril de blesser.
Sur ce il tourna les talons et sortit du bureau à grands pas. Dernière lui, la grotte caverneuse fit entendre l’écho d’un roulement de tambour étouffé. Samuel Pauljacques se poilait littéralement la face, bien que cela n’apportât rien à l’histoire.
Confrontation
Une fois n’est pas coutume, la confrontation survint au moment où Albert s’y attendait le plus.
Albert avait convoqué ses plus proches collaborateurs. Des types compétents, les petites mains industrieuses qui assuraient la prospérité de l’entreprise et qui œuvraient dans l’ombre de Samuel depuis déjà plusieurs mois. Il n’eut pas à jouer de sa position hiérarchique pour les décider à l’aider. Visiblement ils ne partaient pas non plus le fil du big boss dans leur cœur. Ils ne furent pas surprit non plus lorsqu’il leur exposa son projet de s’immiscer à son tour dans le rêve de ce dernier. L’os venait seulement du fait que l’autre ne rêvait pas. Ensemble, ils décidèrent d’agir à l’un des moments où Samuel Poljacques vampirisait la nuit d’un autre malchanceux ayant eu l’imprudence de se trouver sur son chemin, ce qui arrivait de plus en plus fréquemment depuis qu’Albert luttait pour ne pas dormir.
A l’heure dite, ils installèrent Albert dans le lit de son bureau, à côté d’un grand cylindre où baignait le fluide luminescent qu’il présentèrent comme la substantifique moelle de l’interconnexion rêvale.
Dénouement
Un vent frais comme une bourrasque hivernale emporta avec lui des fétus de paille qui parsemaient la rue. Une volée de sable fin vint caresser la joue d’Albert.
Bon sang ! Les deux étés d’Onitopia sont donc passés si vite que l’hiver est déjà là ? Pensa-il.
Albert voulu porter la main au col de son manteau pour le relever sur son cou. Cette dernière ne trouva qu’un pan de cape retenu sur l’épaule par une fibule ornementée. Une douleur poisseuse lui inonda le front. Sa main en redescendit couverte de sang. Il sourit.
Ça a donc fonctionné ! L’appareil de ce pauvre fou fonctionne. Il était en train de rêver le rêve d’un autre. En toute conscience, en toute liberté. Cela ouvrait des perspectives gigantesques, que ce soit en terme d’applications scientifiques ou commerciales. De quoi donner le tournis. Où bien étais-ce cette blessure ouverte à la tête ?
Albert, légèrement nauséeux, renonça a se lever et se contenta d’observer autour de lui, se redressant en position assise.
Le vent qui soufflait dans ce qui ressemblait à une rue terreuse devait-être de ceux qui précèdent le petit jour. Un coup d’oeil circulaire sur ce qui s’avérait être une petite place en forme de carrefour triangulaire, son sol en terre battue, ses façades en bois aux peintures écaillées lui permis de s’orienter grossièrement. Aux visages austères gravés sur le linteau des portes, aux gueules de dragon sortant des poutres qui dépassaient des toits, Albert conclut que s’il se trouvait bien en Onitopia, il devait être dans un tout petit village, un de ceux, nordiques, qui jouxtent les étendues sauvages de la grande mer de glace. « La fin du monde des hommes », comme on le racontait dans des chansons anciennes, « le début du monde des Dieu ».
Albert en profita également pour détailler sa tenue. Des sandales de cuir. Une ceinture tressée au fourreau de laquelle pendait une imposante épée. Incroyable, il était vêtu comme dans les âges anciens et vivait se rêve comme passé à la moulinette d’une machine a remonter le temps. Le village était alors sans doute une grande ville, pour l’époque, une de ces citées nordiques accrochée aux falaises de grès comme le dernier bastion de la civilisation au bord du néant. Il était tout à ces conjectures lorsqu’un amas de vieux chiffons et de paniers se mit à bouger près de lui. Sous la tonnelle qui les habitaient tous deux, sur le même perron de planches de ce qui semblait être une série de boutiques fermées, émergea une le second personnage du rêve.
Une tête terrible, saignant sur une côte matelassée de pourpre et d’or qui avait dû être magnifique. Un soldat sans doute, comme lui mais visiblement en plus piètre état. Le bougre arborait une balafre ensanglantée qui partait de sous son oreille pour aller lui manger une partie du front.
L’esprit d’Albert se refusa de voir plus en détail l’amas visqueux et sale se tenait en lieu et place de ce qui aurait dû être un œil.
L’homme grogna plus qu’il ne gémit, dans un grincement de dent à vous fendre l’âme et entrepris maladroitement d’ajuster un foulard sur sa blessure. Mais Albert n’eut pas le temps de s’interroger plus avant sur le rôle de ce dernier dans l’histoire, car un autre mouvement venait d’attirer son attention au bout de la place vide de monde.
Une silhouette venait d’apparaître en s’écartant d’un mur près de la large avenue qui débouchait à cet endroit. Elle fit mine de s’approcher d’un homme emmitouflé dans un grand manteau et qui descendait l’avenue dans leur direction, puis s’arrêta, leva une main ouverte à hauteur de sa tête, avant de se fondre à nouveau dans l’obscurité. Le grand manteau continua sa progression, tandis de deux nouvelles silhouettes qui émergèrent des deux autres rues débouchant sur la place en cul de sac. A leur tour elles esquissèrent rapidement le même signe de la main.
Des sentinelles, pensa Albert épaté. Ce rêve l’émerveillait positivement, lui qui n’avait personnellement jamais osé s’aventurer dans des territoires oniriques aussi recculés.
L’homme s’avançait seul, d’un pas rapide et souple, droit devant lui. Droit sur Albert.
_ Enfin !
La voix, chaude et rauque avait fait sursauter Albert. Il se retourna pour voir apparaître deux hommes encapuchonnés dont il n’avait pas non plus remarqué la présence immobile, ombres parmi les ombres. L’un d’eux portait son bras en écharpe et vaste auréole sombre maculait son habit au niveau du biceps. L’autre arborait en bandoulière un large cor en corne de Rinocéphale. Un animal disparu depuis si longtemps, une pièce de collection !
Sans plus faire attention à lui, ils le dépassèrent pour aller au-devant du soldat au manteau.
_ Alric ! Alors, quelles sont les nouvelles ?
L’autre jeta un regard vers l’homme à la balafre, celui-ci hocha la tête. Son regard scrutateur glissa ensuite vers Albert toujours assis. Il hocha la tête à son tour, pour le saluer. Albert, qui ne savait trop quoi faire, lui rendit maladroitement son salut de la main.
L’homme au manteau leva ensuite son visage buriné par de longues journées sous le soleil implacable des contrées nordiques et répondit.
_ Il en arrive toujours, cela est bon.
_ Bon ?
Tous se retournèrent vers le bandeau ensanglanté. Albert n’arrivait pas à croire que cette voix forte et autoritaire était bien sortie du tas de guenilles à peu près mourant qu’il avait non loin de lui. C’était pourtant bien le cas.
_ Tu trouves ça bon ? Voici un capitaine des marches septentrionales plein d’optimisme !
Les trois autres baissèrent la tête.
Le blessé repris : « Nous étions 8 000 dans la passe d’Elfin. 2 000 des cavaliers d’argents d’Osthurn sur notre flan gauche, en renfort. Comment parlerais-tu d’une déroute, si c’eut été le cas, Alric ? Comme un sort moyennement bon ? ». Il y eut une pose dans son discourt, comme s’il devait se concentrer pour reprendre le cours de ses idées, ou pour ne pas se laisser submerger par la douleur. « Je ne compte que 30 guerrier autour de nous, dont plus de la moitié sont or d’état de combattre », il baissa d’un ton « certains définitivement. Cette ville sera sans doute notre tombeau et l’espoir d’un monde libre mourra avec nous. »
Ce fut l’homme blessé au bras qui releva la tête le premier.
_ Mais tu nous a amené ici dans un acte de sagesse, Asthor, nous détournant nous et nos camarades d’une mort héroïque mais vaine. Ce n’est sans doute pas pour, maintenant, nous abandonner au désespoir. Tant que nous existerons, une menace pèsera sur le pouvoir des Senzhen.
Albert senti distinctement l’air se charger d’électricité autour de lui a la simple évocation de cette famille. Des tyrans sanguinaires qui hantaient les rêves agités des petits enfants qui n’avaient pas été sage tout au long des journées. « Le grand Senzhen viendra te chercher si tu en finit pas ta soupe ! ». « les temps héroïques », pensa-t-il, rien que çà ! Il m’a entraîné en pleine guerre des clans, 3 000 ans avant notre ère. Avant même la chute de la petite lune Cliopée, avant les âges sombres et la seconde renaissance ! Et lui, qui va-il bien être ? Le grand Senzhen lui-même ?
Après un silence, le dénommé Asthor reprit, d’une voix calme : « Quel est l’état des lieux capitaine ? ».
Le capitaine Alric se tourna d’un bloc vers lui dans une posture parfaite de respect militaire.
_ Mes informateurs font état d’autres rassemblements à l’extérieur de la ville. Peut-être plus importants que le notre. Les échevins de la citée ont pris le partis de ne rien tenter contre nous. Ils nous craignent autant qu’ils craignent l’armée des Senzhen et ne feront pas donner la garde.
_ Pour l’instant, prononça Ashtor, dubitatif. Nous n’avons plus de temps à perdre. Manis, sonne l’appel.
Aussitôt dit, aussitôt fait. L’autre emboucha son cor et, après une profonde aspiration, le fit retentir dans ce qui sembla à Albert un roulement de tonnerre gigantesque qui aurait remuer ciel et terre mais sans éclair.
La réponse ne se fit pas attendre. L’instant d’après, une trompe identique raisonna dans le lointain, puis une seconde.
Autour d’eux une vague d’allégresse se rependit sur la place. La rumeur gonfla depuis la petite halle couverte qui leur faisait face à droite. Les cris de joies se transformèrent vite en toux et en gémissement. Albert imagina plus qu’il ne vit les dizaines de blessés dont Ashtor avait parlé. Il n’eut pas le temps de plus y penser. Déjà, les ordres étaient donnés et une colonne de cinq hommes, comportant les trois qui l’entouraient et deux des guetteurs se mit en route pour tenter d’effectuer une jonction avec les autres forces rebelles.
Lui, était assigné au guet de la rue qui venait de droite.
L’avantage avec les rêves, c’est qu’on a pas spécialement besoin de se mettre debout ou d’étirer ses membres endoloris par une trop longue station dans une position inconfortable. L’unité de temps, comme celle de lieu, n’est pas forcément respectée et c’est pour ça qu’Albert grimaça dans son lit lorsqu’une vilaine douleur se mit à l’élancer depuis sa fesse droite. Sans autre forme de procès, elle étendit ses doigts froids et secs jusqu’au petit orteil situé latéralement du même côté. Il n’eut cependant, là encore, pas le temps de méditer sur cette incongruité peu souhaitable car cette dernière cessa immédiatement pour laisser la place à une seconde douleur, plus circonscrite et cette fois localisée dans son oreille droite.
Il roula a ses pieds. La présence de ce petit caillou blanc lui en apprit autant sur ce qui lui faisait maintenant affreusement mal que l’arrivage d’un second, en pleine face cette fois, sur la route de son front déjà sanguinolent. Ayant un tant soit peu déterminé la source de son tracas, Albert pu, cette fois se protéger en levant instinctivement la main. Le projectile ainsi dévié alla heurter le volet fermé d’une fenêtre dans son dos : Il avait maintenant mal à la main. Mais il était parvenu à déterminer, même grossièrement la provenance du projectile. Si l’on devait en croire sa trajectoire sinusoïdale, celui-ci venait d’une des fenêtres de l’immeuble d’en face.
Aïe dans la jambe. Ils arrivaient drôlement vite dites-donc. Albert se précipita enfin vers le couvert que représentait la halle devant lui. Sur le chemin il ne pris pas garde d’éviter caisses et ballots disséminés, tant les projectiles étaient réguliers et douloureusement précis.
Une fois à l’abri il fut agressée par l’odeur de chair rance et passée qui flottait autour de lui. Les blessés, pensa-t-il, mais alors grièvement là. Les cailloux continuaient, impassibles, à ricocher autour de lui.
Vlang ! Contre le poteau derrière lequel il s’était réfugié.
Troisième fenêtre, 1er étage.
Albert risqua un coup d’oeil. Devant la fenêtre derrière laquelle une forme humaine venait de disparaître, il observa un monceau de caisses de bois. Un escalier de fortune, cela fera, pensa-t-il. Albert n’avait aucun doute sur l’identité de celui qui, d’une façon ou d’une autre, venait réclamer sa place dans ce rêve héroïque.
Albert sentit le cuir de ses sandales trembler. Un grondement sourd mais tangible remonta le long de ses chevilles pour inonder son bas ventre. L’éruption était totale et à son point culminant Albert sentit le rouge lui monter au front.
Bang !
Le soldat qu’il était jaillis de derrière le poteau où il avait trouver refuge et partit d’un bond vengeur à l’assaut de l’empilement de cageots qui le séparait de al fenêtre assassine.
Ce fut les dents serrées qu’il en effectua l’ascension en un mouvement coulé et sûr. Une vrai recrue de troupe d’élite à l’entraînement. Pas mal pour un cadre quadra et bedonnant. La colère l’avait transfiguré et son visage montrait les dents : il était la revanche personnifiée, le bras séculier de la vengeance fait homme. Bref, en un mot comme en cent, l’adversaire s’en retourna promptement.
Notre Albert sautant à l’intérieur, une main sur le rebord de la fenêtre, écumant, tel un pirate à l’abordage, découvrit la silhouette de dos du malfaiteur ainsi qu’un lance pierre lâchement abandonné au sol. L’autre sorti de la pièce sans un regard en arrière. Ni une ni deux, voilà l’Albert qui s’engouffre dans l’embrasure encore tiède, prêt à en découdre. S’ensuit une course poursuite digne d’un film de cape et d’épée dans les escaliers de bois. Lui, portant la cape, et l’autre, ben l’autre… courant devant. Toc, sur de pallier ! Zou, dans le couloir ! Hop, grimpant une échelle donnant sur le toit.
Ha ! Je tient ta botte, malotru !
Ouille, il prend cette dernière dans le coin de l’œil.
Crac, c’est repartit sur le toit maintenant. Tagada, tagada, hop, sur le toit de la maison voisine.
Pas essoufflés pour un sous, nos deux rêveurs s’adonnèrent à leur course effrénée, de toit en toit, de maison en maison, sans se soucier du danger qui les guettait en contrebas. Du côté de la place, le bas des gouttières culminait à 8 ou 10 mètres de haut. Cela était suffisant pour se faire mal. Mais du côté opposé… La ville la plus au Nord du monde émergé d’Onitopia avait été construite, tel le phare mythique de la civilisation face aux éléments indomptés, sur le rebord de la dernière falaise du dernier à pic rocheux. Ultime rempart à l’orgueil des empires. Dernier bastion de l’humanité conquérante, horizon septentrional à la folie des hommes. En dessous, une mer déchainée en permanence, de plus en plus froide au fil des siècles, un désert liquide peuplé de monstres et de récits mythiques.
Coincé à droite par un étendoir salement chargé de linges humide, acculé derrière lui et à sa gauche par le vide abyssal des étendues hostiles, l’énergumène fit soudain volte face. Samuel en cuir. Le même que dans le bureau du sous-sol, les tuyaux en moins. Poussant un hurlement de rage, plus par désespoir que dans l’intention de nuire, Albert se jeta sur Sam et le percuta violemment à l’abdomen. L’autre alla heurter le rebord du coccyx et bascula en arrière sans un cris mais en prenant soin de s’agripper à la lanière de flanelle qui ceignait l’épaule d’Albert et supportait le fourreau de son épée.
Dans une seconde qui lui sembla une éternité, Albert se vit happer par le vide avec cette sensation désagréable de devoir emporter comme dernière image dans sa tombe le visage ignominieux de son persécuteur. Un sourire carnassier sur le visage du mépris. Bien entendu cela dura effectivement un peu plus d’une seconde. Ils vinrent ensuite heurter violemment quelque chose de dur et de froid. Surtout Samuel. Albert, lui, heurta violemment quelque chose de tiède et relativement mou et cria : « Houlala, Houla, Hou, que ça fait mal ».
Ni mort ni réveillés, les deux compères se redressèrent lentement, hébétés, surtout Albert, à peu près pour les mêmes raisons que tout à l’heure.
Il leva son regard vers la falaise. Tout en haut, de petits point scintillants de lumière pas plus gros que des lucioles aperçus de loin, lui donnèrent une idée de la distance de laquelle ils étaient tombés. Sous ses sandales, une épaisse couche de neige semblait recouvrir par endroit, surtout dans les creux, d’immenses vagues d’écumes, figées par le gel dans une caricature d’estampe japonaise.
Diable !
Les yeux d’Albert s’habituèrent à l’obscurité le temps que Samuel s’habitue à la douleur et qu’il se redresse en gémissant.
Ils se tenaient tout deux interdits devant l’immensité blanche d’un tableau surréaliste : sur le fond laiteux de l’écime glacée, des traces noires, crénelées, se déroulaient rectilignes et à perte de vue ! Sans se concerter ils se mirent à avancer, somnambules perdus dans les affres incroyables de ce que la conscience ne peut accepter.
Dans le rêve comme dans la réalité, ils avaient grandit dans la certitude de la finitude de leur monde. De mémoire d’homme ce lieu en avait toujours été une frontière. Et voilà qu’ils étaient, bien malgré eux, passés de l’autre côté. Or, de monstre il n’en voyait point, de mer, qu’une surface blanche plus plate et lisse à mesure qu’ils avançaient et rien que ce tracé noir qui avait toutes les apparences d’une structure organisée.
Albert se tourna vers Sam. Le visage du méchant homme exprimait maintenant toute la stupeur possible. L’autre lui rendit son incrédulité, il n’en avait que faire, inondé qu’il était déjà par ce même sentiment. Les choses noires, fixées en de longs serpentins parallèles sur le sol semblaient répondre à une certaine organisation. Des signes, voilà à quoi cela faisait penser. Des signes noirs, d’une vingtaine de centimètres, accrochés les uns aux autres. Comme les traces d’un chariot, une roue dentelée, mais de petits interstices mettaient entre leurs séries de petits vides ici et là. Et puis les traces de chariot vont par paires… sous leurs yeux se développait des dizaines, des centaines de ces lignes noircies sur la blancheur immaculée de l’étendue neigeuse qu’ils arpentaient.
Samuel et Albert se mirent sans réfléchir à suivre les traces sur la neige. Là où le vent les découvrait complètement il se mirent à voir des choses. Des choses qui se trouvaient enfouie dans leur mémoire de rêveurs rêvés. Albert mis un genou à terre pour mieux observer.
_ C’est quoi, c’est des mots ?
Albert se redressa. Sans répondre, il se mit à nouveau à avancer vers le large, suivant ainsi la succession des écritures sur la glace du sol. Samuel suivit docilement, en tenant les côtes brisés dans ses bras comme un fragile enfant.
_ Des phrases ? C’est un texte écrit ? Albert en répondant pas il prit son silence pour acquiescement. Mais si c’est des phrases, qu’est-ce qu’elles font ici, dans cette étendue gelée du grand nord, au bout du monde ? Ça n’a pas de sens.
Albert se retourna.
_ Ça a un sens, dit il, le voici. Il pointa son doigt vers l’horizon et se remit en marche en reprenant sa lecture. Il y avait quelque chose d’étrangement familier dans ce qu’Albert lisait. Comme dans ces moments fugaces où l’on fait l’expérience du « déjà vu », il lui semblait être en mesure d’anticiper le mot suivant dans son improbable lecture au sol. Il avait en avait le goût sur le bout de la langue, puis il le lisait. Comme s’il avait lui-même écrit ces mots, pas sur la glace ici, mais sur une feuille blanche… ailleurs, avant. Albert était entré dans le rêve d’un autre. Le rêve de Samuel Pauljacques. Il avait expérimenté la texture d’un monde onirique par procuration, étrange sensation en soit, mais ça, c’était encore différent. Ni pleinement sien, ni parfaitement autre.
Dernière lui Samuel semblait peu à peu reprendre possession de ses moyens. Il s’était redressé et la douleur lancinante qui jusque là occupait la presque totalité de sa conscience refluait peu à peu.
Albert lisait : « …et pour cela le protocole expérimental ne doit souffrir d’aucune interférence. En aucun cas les affects du rêveur ne doivent être parasités par quelque autre peuplement onirique sous peine de voir se développer un conflit sans fin au cœur même de la structure psychique du sujet. ». C’était ses mots à lui. Le concept même de peuplement onirique était son bébé à lui. Un artifice de langage qui lui avait permis, dix ans auparavant de décrocher sa place dans l’observatoire principal d’Onitopia, comme chercheur. Un concept qui, en formalisant l’expérience individuelle dans le rêve, lui avait permis de construire la théorie des liens paradoxos qui… Théorie qui… Albert n’arrivait pas à retrouver l’application fondamentale de sa théorie, son, œuvre, l’œuvre de sa vie. Il reprit sa lecture où son esprit vagabond l’avait laissée : « La texture même du rêve étant tissée des filaments d’expériences individuelles du sujet, les liens de rêveurs à rêveur sont, en faisant intervenir des expériences exogènes ayant déjà subit le traitement et l’ordonnancement d’une structure mentale particulière, susceptibles d’occasionner des perturbations…. ». Il n’eut pas l’occasion d’en lire plus. Un craquement lugubre se fit sentir et une crevasse monumentale déchira la glace qui tout autour de lui se mit à luire d’une lumière liquide. Après un cri rauque et inarticulé, Samuel, son ennemi intime, se jeta sur lui et entrepris de l’étrangler méthodiquement. En quelque sorte on aurait pu dire que les choses rentraient dans l’ordre. Albert était plutot rassuré. C’était bien le rêve d’un autre, percuté par ses propres souvenir personnels. Depuis quand rêvait-il ? Était-il à la tête de la section paradoxale de l’entreprise ? Et Samuel Pauljacques, existait-il ?
Autant de questions qui ne pourraient trouver leur réponse que lorsqu’il se réveillerait.
Mais il ne se réveilla pas. Et oui, les histoires ne finissent pas toutes bien.